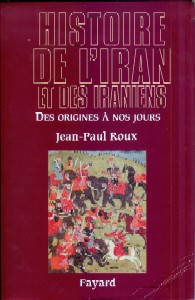
Les Iraniens aiment les histoires. Celle que raconte Jean Paul Roux dans son ouvrage sur « l’Iran et les Iraniens des origines à nos jours » est pluri-millénaire. Bien avant notre ère, les habitants de la Perse vivaient déjà dans des palais. Mais ces trois millénaires semblent n’avoir pas altéré la capacité légendaire du Perse à s’adapter. Invasions étrangères, occupations territoriales, nouvelles religions imposées par les vainqueurs militaires ou par des usurpateurs après un coup d’Etat, rien n’y fait : hier comme aujourd’hui, l’Iranien semble imperturbable. Il attend son heure. Il profite de ce délai pour découvrir et puiser dans le malheur qui le frappe une source d’enrichissement. Interrogez un iranien contemporain peu suspect de soutien au régime islamique et il vous déconcertera par sa réponse : « Dans cinquante ou cent ans, on verra bien ! ». Faut-il déceler dans cette attitude la fameuse « takiye », élément central de cette psychologie typiquement iranienne évoquée trop rapidement par Jean Paul Roux dans son introduction ? Elle décrit cette capacité de dissimulation qui, face aux exigences du persécuteur, autorise le recours au mensonge afin de préserver familles et biens.
L’auteur a consacré de nombreuses années à l’étude des peuples d’Orient et aux civilisations indo-européennes. Mais au « soir de sa vie », il reconnaît l’irréductible attraction qu’exercèrent sur l’ensemble de son œuvre, le pays de l’Aryana, l’Iran et l’Afghanistan « sous son nouveau nom », et ses peuples « aryens par excellence », terme qu’en iranien ancien comme en sanscrit, on continue de traduire par « noble ».
Peut-être est-ce cette noblesse qui suscita tant de convoitise. Les conquérants se sont en effet bousculés aux portes de l’Iran : dès la genèse du VIIème siècle avant notre ère, les premières invasions scythes traversent des territoires déjà occupés par les Mèdes et les Perses, peuples unis – déjà – contre les Mésopotamiens. Ils formeront successivement les empires initiaux annonçant la grande dynastie des Achéménides. Le ton est donné. Hégémonie grecque d’Alexandre le Grand, interventions chinoises, conquête arabe des Omeyyades, domination turque puis invasions mongoles « dévastatrices », sans oublier les incursions russes de l’époque moderne rythment l’histoire de ce plateau d’Iran. Si ces « hôtes de passage » ne ratent jamais une occasion de faire couler le sang, ils savent aussi apporter dans leurs bagages, une culture religieuse dont des bribes viendront régulièrement nourrir la psyché iranienne. Dans la nuit des temps – entre le XIVème et le VIIème siècle avant notre ère ! – se perd l’origine du mazdéisme dont l’auteur se demande si Zoroastre (Zarathoustra) en fut le fondateur ou un simple réformateur. Voire même s’il a simplement existé. A cet édifice historique, les autres monothéismes apporteront leur pierre. D’où des passerelles troublantes avec le christianisme ou avec l’islam, repérées par l’auteur qui évite néanmoins tout syncrétisme. Si la religion de Mahomet finit par s’imposer en Iran en 1501, elle ne le sera que sous sa forme marginale, le Chiisme. Comme elle ne pourra pas davantage éradiquer les fondations originaires. Aujourd’hui encore, les Iraniens célèbrent la fête zoroastrienne du dernier mercredi avant le nouvel an. Cette célébration permet à tous les habitants d’un quartier de se réunir autour d’un feu, nourri de vieux mobilier domestique. Il donne lieu à un rituel particulier : les plus jeunes prennent leur élan, se précipitent sur les flammes qu’ils enjambent en prononçant une formule incantatoire visant pour l’année à venir, à « jeter au feu ses faiblesses et à prendre de celui-ci sa force ». Placé sous la haute surveillance des comités islamiques, cet événement en précède un autre, celui du treizième jour après le nouvel an iranien. Moins suivi à l’époque moderne, il consiste à quitter la maison pour passer une journée entière à la campagne ou en forêt, le temps de « laisser les mauvais esprits » vider les lieux qu’ils occupaient l’année précédente.
Apport mais pas fusion. Le « grand conservatisme » de langue iranienne en témoigne. Sous le califat de Damas, la langue arabe sera adoptée provisoirement avant d’être finalement « répudiée » . Langue, religion, culture, l’Iranien emprunte mais ne se perd pas. Il préserve son intimité. D’où cette nette distinction toujours en vigueur entre « biroun » et « andaroun », ce qui se passe à l’extérieur de la maison et les agissements à l’intérieur des murs, littéralement du gynécée. Dans le Mazdéisme, le « soi qui préexiste » n’est-il pas féminin ?
Jean-Paul Roux, Histoire de l’Iran et des Iraniens, Des origines à nos jours, Fayard, 2006, 513 p., 25 euros.
Jlvannier@free.fr
06 16 52 55 20




