
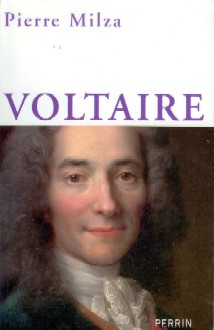
Un homme qui, de surcroît, ne trahira jamais sa seule passion, celle pour le théâtre contractée lors de son passage au collège Louis-Le-Grand, le tout sur fond d’enseignements jésuites, de joutes oratoires et de libre accès théorique aux idées modernistes, qui auront probablement contribué à l’exacerber. Est-ce la fréquentation de ce milieu, le besoin d’une reconnaissance pour celui qui n’était pas issu d’un « lignage aristocratique », le rejet par son frère après la mort d’un géniteur qui le laissait volontairement – une fois encore – abandonné sans le moindre sous, les incertitudes sur sa filiation, toujours est-il que le jeune Arouet semble très tôt « dévoré », selon ses « pères », par son appétit de célébrité au point d’endosser les habits d’un personnage incroyablement cabotin.
Au libertinage de ses amis qui lui font découvrir « l’enclos du Temple », Voltaire, qui déjà adolescent a connu « les genoux » de la sulfureuse Ninon de Lenclos, trouve encore davantage de plaisir aux ingérences dans la politique du royaume : signe du niveau de ses ambitions, il s’entraîne, si l’on ose dire, en faisant circuler des vers satiriques contre le Régent. Avec, pour récompense avérée de son génie, une année entière de sa vie à la Bastille. Grandiose jusqu’au bout, Voltaire se paiera, en quelque sorte, et le Régent et le luxe d’une ultime perfidie son encontre : lors d’une entrevue avec celui qui voulait – pour se faire pardonner l’embastillement du jeune auteur – , lui octroyer une pension alimentaire, Voltaire ne put s’empêcher de lui lancer, feignant la plus parfaite innocence : « Je remercie Votre Altesse royale de ce qu’elle veut bien se charger de ma nourriture mais je la supplie de ne plus se charger de mon logement. ».
Voltaire écrit des pièces de théâtre dont Pierre Milza sait merveilleusement nous restituer le cadre historique et l’atmosphère vivante dans lesquels elles étaient interprétées à l’époque. Il nous dépeint ainsi un jeune auteur enthousiaste, partagé entre ses convictions naissantes et les impérieuses nécessités de la censure qu’il s’emploie à contourner, déployant en outre des trésors d’argumentation pour convaincre les acteurs de la Comédie Française de bien vouloir accepter ses œuvres. Il nous le montre encore, les accompagnant aux répétitions ou dissimulé le soir d’une première afin d’épier les commentaires ou de contrer, si besoin est en surgissant lui-même sur la scène, d’éventuelles cabales montées contre lui par ses adversaires. Fantastique époque où le public, à moitié sur la scène ou sur le fond, s’invective également de loges à loges, le tout dans un « charivari de portes ouvertes et claquées ».
Vie trépidante, infatigable combat d’un homme engagé comme on pourrait le dire de nos jours d’un intellectuel si l’expression n’était pas anachronique et galvaudée par l’incarnation contemporaine de pâles copies du maître. Rossé, pourchassé et réfugié à l’étranger, François-Marie Arouet ne déviera pourtant jamais de son chemin de pensée – une lutte aussi intransigeante que peut l’être l’obscurantisme à son égard – même s’il emprunte pour cela des routes aux directions géographiques incertaines : Bruxelles, les Pays-Bas, Londres où il ne manque pas de flatter le roi George II, et la Prusse, marquée par de tumultueuses relations – pas seulement épistolaires- avec son protecteur Frédéric II. Entre-temps, il trouve un double refuge : économique car ce fou des planches sait aussi se révéler un spéculateur redoutable au point, dit-il un jour, d’avoir su faire « tripler son or ». Affectif ensuite par sa rencontre en 1733 avec la marquise Emilie du Chatelet, amante et complice, dont il pleurera à sa mort, « la perte d’un ami de vingt ans ». Interdit de séjour à Versailles, Voltaire opte pour le village suisse de Ferney, d’où il livrera, tout en y faisant construire un théâtre de deux cents places, ses plus grandes batailles pour la défense des persécutés : le pasteur Rochette, Jean Calas, Pierre-Paul Sirven, La Barre, autant de cas à même de lui fournir de la matière pour la rédaction de son « Traité sur la Tolérance », époque à laquelle la rupture avec l’autre philosophe de son temps, le genevois Jean-Jacques Rousseau, est définitivement consommée.
S’il passa sa vie à « écraser l’infâme », Voltaire n’en fut pas moins, selon Pierre Milza, une « personnalité plus sensible que ne le laisse apparaître son opposition caricaturale au sentimentalisme de Rousseau ». Monarchiste fidèle, il fut en outre et jusqu’à la fin de sa vie, un adepte d’une « religion naturelle », forme de théisme qui lui fit admettre l’existence d’un grand horloger de l’univers. En témoigne cette savoureuse anecdote tellement révélatrice d’un homme pourtant au seuil de la mort : un matin vers trois heures, il fait lever un de ses hôtes auquel il demande de l’accompagner pour une promenade jusqu’au sommet d’une petite montagne. De là, celui qui l’assiste dans sa randonnée matinale raconte la levée du jour : « le spectacle était magnifique…Voltaire est saisi de respect, il se découvre, se prosterne et, quand il peut parler, ses paroles sont un hymne : « Je crois, je crois en Toi », s’écria-t-il avec enthousiasme…Dieu puissant, je crois ! ». Mais tout à coup, se relevant, il remit son chapeau, secoua la poussière de ses genoux, reprit sa figure plissée et regardant le ciel comme il regardait parfois le marquis de Villette lorsque ce dernier disait une naïveté, il ajoute vivement : « Quant à Monsieur le Fils, et à Madame sa Mère, c’est une autre affaire ».
Pierre Milza, « Voltaire », Editions Perrin, 2007, 915 p., 26, 50 euros.
