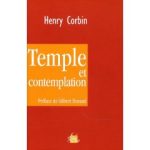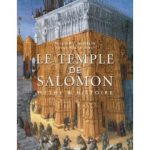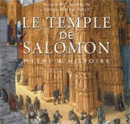
« Noli foras ire, in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas ». Inutile, expliquait Saint Augustin, d’aller chercher à l’extérieur une vérité que l’homme peut trouver dans sa conscience intérieure. Ou dans son temple intérieur si l’on adopte la pensée du maître du chiisme mystique Henry Corbin pour lequel « le contemplateur, la contemplation et le temple ne font qu’un ». La métamorphose qui s’opère dans le temple, insiste-t-il dans une réédition bienvenue de son ouvrage « Temple et contemplation » aux éditions « Entrelacs » et dans lequel ses successeurs ont voulu discerner un testament spirituel, c’est celle de l’homme qui l’amène à « naître en lui-même ».
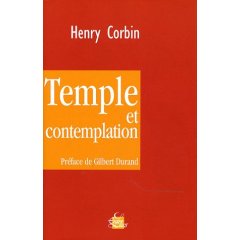
Dans un temple protégé des perturbantes influences extérieures, du vent et du verbe profanes toujours prompts à s’infiltrer sous les portes, dirait-on aujourd’hui, le temps devient « espace ». Mais un espace infini, « messianique » précise Corbin. C’est à dire que l’on retrouve les caractéristiques de ce temple indépendamment des lieux et des époques comme si l’être humain en transportait l’essence au fond de son cœur. L’auteur illustre facilement son propos en rappelant que le temple sabéen est par excellence un temple-archétype. Une inscription d’inspiration socratique au seuil du grand temple de Harrân (ancienne Carrhae de Mésopotamie, aujourd’hui située en Turquie) est ainsi rapportée par Masudî, surnommé l’Hérodote arabe de par ses multiples voyages au cœur du monde islamique du Xème siècle : « celui qui se connaît soi-même est déifié ». La religion des Sabéens de Harrân prolongeait ainsi, selon Corbin, les anciens cultes syriens « réinterprétés à l’aide d’éléments empruntés à la philosophie platonicienne ».
Le voyage dans le temple vise évidemment au décentrement à la fois mystique et initiatique de l’individu : mort et résurrection mais aussi exil, tout intérieur, que Henry Corbin n’hésite pas à déceler dans un hadith du Prophète : « l’Islam a commencé expatrié et reviendra expatrié ; bienheureux ceux-là qui s’expatrient ». Ainsi l’Ismaélisme intègre selon lui « cette répétition mentale du sacrifice d’Abraham », acte par excellence d’un rituel ésotérique de mort spirituelle et de régénération. Un « renoncement au désir charnel de possession », nous précise encore Corbin, au profit de l’enfant de l’âme. Le destin de l’édifice accompagne celui de l’homme. Dans sa pensée, le temple n’est pas un lieu abstrait, purement figuratif mais, construit et nourri de l’humain qui s’en inspire, il abrite également l’esprit et le souffle divins. Toute destruction physique du temple entraîne une altération de l’humanité. Symboliquement, celle-ci constitue pourtant une étape nécessaire pour la « naissance de l’homme au monde de l’exil », une « traversée » destinée à lui permettre d’atteindre le nouveau monde porté par une relation spirituelle entre le peuple et son Dieu. Un Dieu de retour par la « porte orientale » du temple. Le passage du physique au cosmique s’effectue, si l’on ose dire, à ce prix.
D’où le dernier chapitre de son ouvrage, certainement l’un des plus admirables pour sa mise en relation de connaissances qui s’ignorent, et consacré à « l’Imago Templi » de Sohravardî. Il l’ouvre par une citation d’Elie Wiesel tirée du Talmud : « si les peuples et les nations avaient su le mal qu’ils se faisaient à eux-mêmes en détruisant le Temple de Jérusalem, ils auraient pleuré plus que les enfants d’Israël ». Lorsque Sohravardî mentionne la Lumière de la présence divine dans le temple, la « Sakîna », il ne fait rien d’autre que reprendre, nous explique Henry Corbin, son équivalent hébraïque, la « Shekhina » : la mystérieuse présence divine dans le Saint des Saints du Temple de Salomon. Le passage au manuscrit de Qumrân, au nouveau Temple des Esséniens et à l’ésotérisme chrétien de Maître Eckhart ou celui de la Chevalerie templière, en passant par le « remplacement du temple par Jésus », s’impose comme s’établit l’évidente osmose entre liturgie céleste et liturgie terrestre. La circumambulation autour de la Kaaba ne vient-elle pas rappeler le rituel angélique dont Mahomet fut le témoin lors de sa montée au Temple céleste?
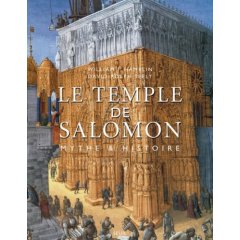
Henry Corbin, « Temple et contemplation », Préface de Gilbert Durand, Editions Entrelacs, 2007, 478 p., 21 euros.
William J. Hamblin et David Rolph Seely, « Le temple de Salomon, mythe et histoire », Editions du Seuil, 2007, 222 p., 38 euros.